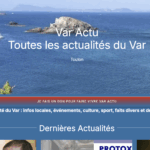Entre novembre 2018 et mars 2023, plus de 17 millions de manifestants ont été recensés en France selon le ministère de l’Intérieur. Derrière ces chiffres, se cache un contexte social de plus en plus tendu comme l’illustrent les quatorze journées de mobilisation contre la réforme des retraites entre janvier et juin 2023.
Pour les journalistes locaux, la couverture de ces mobilisations soulève des dilemmes concrets : comment approcher des rassemblements non encadrés ? Jusqu’où aller au cœur de l’action sans se mettre en danger ?
Immergés dans leur territoire, ces reporters connaissent les acteurs, les codes, les colères. Cette proximité est précieuse, mais elle expose. Ludivine Bleuzé, reporter pour L’Union dans l’Aisne résume : « Le contact humain est essentiel. Il faut toujours expliquer pourquoi on est là. »
Connue localement, elle peut accéder plus facilement aux manifestations… mais aussi devenir une cible. Même constat pour Laetitia Lemaire, rédactrice en chef adjointe de Réussir le Périgord, un hebdomadaire spécialisé dans l’agriculture. Depuis quatorze ans, la journaliste suit les mobilisations agricoles en Dordogne. « On connaît les problématiques, ça nous permet d’être plus pointilleux sur les questions. » Grâce à cette légitimité, elle peut accompagner les cortèges depuis les tracteurs, au cœur des barrages et des actions coup de poing. « Les agriculteurs sont très respectueux lors des manifestations. »
Informer quoi qu’il en coûte ?
Mais cette relation repose sur un équilibre fragile. Si certains syndicats agricoles collaborent avec la presse, d’autres, comme la Coordination rurale, ferment la porte. « Leur président nous accuse d’être inféodés aux autres syndicats », déplore Laetitia Lemaire. Face à ce blocage, elle privilégie le terrain : « On passe directement par les manifestants. ça évite la langue de bois des institutions. »
Mais lorsque les cortèges quittent les campagnes pour les grandes villes, les repères s’effacent. À Lille, alors qu’elle travaillait pour France Bleu, Laetitia Lemaire a couvert des rassemblements plus tendus : « On peut vite se retrouver entre des CRS et des manifestants violents. Il faut poser ses limites : jusqu’où aller pour informer sans se mettre en danger ? » Ludivine Bleuzé témoigne également de cette bascule. Partie de Soissons (Aisne) avec des ouvriers en route vers Paris, elle se souvient d’une manifestation « familiale » stoppée net par les CRS. Pire : enceinte de quelques semaines lors d’un autre reportage sur Soissons, elle a été visée par un jet de pétard. « C’est la première fois que j’ai eu vraiment peur. » À force d’être présents, ces journalistes deviennent des visages connus. Un atout, mais aussi un risque. « Certains manifestants nous voient comme des alliés, d’autres comme des ennemis. Il faut sans cesse rappeler qu’on est là pour témoigner, pas pour prendre parti », insiste la reporter de L’Union.
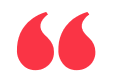
« Il faut sans cesse rappeler qu’on est là pour témoigner, pas pour prendre parti.»
Ludivine Bleuzé, reporter à L’Union
Une position d’autant plus délicate dans un climat de défiance envers les médias — 62 % des Français disent ne pas leur faire confiance sur les grands sujets d’actualité selon un sondage Verian pour La Croix (2025). Les rassemblements non encadrés par les syndicats, comme ceux des Gilets jaunes, rendent les choses encore plus complexes. Pas de porte-parole, pas de structure. Accusée d’être « pro-gouvernement » lors d’un reportage, Ludivine Bleuzé confie : « On s’adresse à une foule multiple, à des colères diffuses. Et parfois, cette foule te rejette. » Pour la journaliste, le seul moyen de faire face à la foule est d’abord de s’adresser à certaines individualités bien ciblées.
Malgré cette tension permanente, les journalistes locaux restent des relais indispensables. « Au contact des manifestants, tu fais des rencontres, tu entends des témoignages et des informations qu’aucun discours officiel ne dira », souligne la reporter de l’Aisne.
Malgré les risques et les difficultés, les deux journalistes s’accordent à dire que la présence sur le terrain est essentielle. Laetitia Lemaire résume leur mission: « On est là pour traduire la parole du terrain vers le reste de la société.»
Elisa Courcol
Insulté, agressé : le nouveau jargon journalistique ?
Témoins de violences lors de manifestations, certains journalistes deviennent aujourd’hui une cible. Comment s’y préparer ? Pour se protéger, la consigne est claire : être identifiable. Carte de presse en poche, brassard « presse » au bras et enregistrement auprès des autorités. Mais est-ce suffisant ? Non, selon le Syndicat national des journalistes (SNJ) et la CFDT.
« Les journalistes ne connaissent pas assez leurs droits », estime Élise Descamps, secrétaire générale de la CFDT. Pour y remédier, le syndicat publie des articles et met à disposition une foire aux questions sur son site. Elle souhaite aussi rendre plus accessible le Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO), un document du ministère de l’Intérieur censé guider les forces de l’ordre dans le respect des droits des journalistes. « Nous ne sommes pas libres de tout, mais nos libertés écrites doivent être respectées », insiste-t-elle. Cette position est aussi partagée par Agnès Briançon, co-première secrétaire générale du SNJ. « Entraver la liberté de l’information n’est pas recevable. Nous en discutons avec le gouvernement dans un groupe de contact pour trouver des solutions.»
Pour Olivia Hicks, médecin du travail à l’AFP, les journalistes ne sont pas suffisamment préparés aux risques psychologiques du terrain. « Quand on pense à un événement traumatisant pour un journaliste, on pense tout de suite à celui qui couvre la guerre. » Elle travaille pourtant avec ceux confrontés à la violence des manifestations, souvent oubliés. À l’AFP, elle propose des formations internes pour les aider à anticiper, traverser et digérer ces situations. Mais elle insiste surtout sur une aide encore méconnue : jusqu’à 2 400 euros de prise en charge par la mutuelle Audiens pour consulter un psychologue spécialisé. Pigiste ou non, tout journaliste qui y est affilié peut en bénéficier.